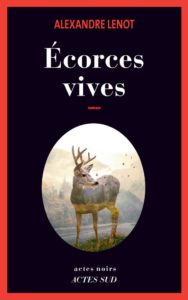 Il est de certains romans dont on sait rapidement qu’ils vont plaire et avoir du succès. Pour Écorces vives certains éloges sont attendus, pour vanter la nature qu’il raconte, et la qualité d’écriture, loin de la mode des phrases courtes. Rien d’usurpé. Le paysage que l’on découvre est celui d’une nature sauvage où les carcasses de tracteurs rouillent en haut des montagnes. L’écriture imprime rapidement sa marque et une ambiance, jouant de l’opposition (« Il aurait voulu avoir de la dynamite. Il n’avait que de l’alcool, dans lequel il venait de se noyer. ») et d’images fortes (« Leurs yeux aux aguets demandaient qui était cette étrangère, débarquée de nulle part, avec son regard de rapace et ses airs sombres de prédatrice. Leurs yeux semblaient dire que les buses, on peut les abattre. »)
Il est de certains romans dont on sait rapidement qu’ils vont plaire et avoir du succès. Pour Écorces vives certains éloges sont attendus, pour vanter la nature qu’il raconte, et la qualité d’écriture, loin de la mode des phrases courtes. Rien d’usurpé. Le paysage que l’on découvre est celui d’une nature sauvage où les carcasses de tracteurs rouillent en haut des montagnes. L’écriture imprime rapidement sa marque et une ambiance, jouant de l’opposition (« Il aurait voulu avoir de la dynamite. Il n’avait que de l’alcool, dans lequel il venait de se noyer. ») et d’images fortes (« Leurs yeux aux aguets demandaient qui était cette étrangère, débarquée de nulle part, avec son regard de rapace et ses airs sombres de prédatrice. Leurs yeux semblaient dire que les buses, on peut les abattre. »)
Alexandre Lenot ne place pas la ville contre la campagne, il n’idéalise pas la ruralité, bien au contraire. Car dans la campagne qu’il décrit, la bêtise règne, incarné par des spécimens humains peu reluisants. Seules quelques figures surnagent, le gendarme boiteux, la veuve à la peau brune, la jeune fille blessée, l’homme plein de chagrin. La communauté, elle, ne produit que violence et jalousie, foule menaçante et lâcheté des faibles.
Certaines scènes, magnifiques, dures et émouvantes, illustrent ce propos. Lison, la veuve, conduit un soir sa voiture en plein milieu d’un champ, seule avec une couverture pour pleurer son amour mort. Louise, la jeune fille blessée, affronte la bêtise des hommes et leurs hormones un jour sur son vélo. La peinture rouge sera son exutoire, un cri Apache et sauvage qui va faire trembler toute la vallée. La solidarité s’organise entre bêtes sauvages.
Du côté de l’écriture, une certaine emphase prend souvent le pas « Ce n’est que maintenant, dans les débris de sa vie, en comptant ses plaies et en remontant le fil de ses cicatrices, qu’il sait enfin tendre l’oreille vers le silence caché dans l’illusion du monde. » D’autre fois, la scansion fatigue : « Ce qu’elle sait, c’est le mystère de cette voix, de la voix de la femme la plus seule du monde, de la voix de la femme la plus seule du monde qui chante la première fois qu’elle a vu le visage de cet homme, la première fois qu’elle a embrassé le visage de cet homme, la première fois qu’elle s’est allongée près du visage de cet homme. » La scansion fatigue, un autre paragraphe, plus loin, est de nouveau rythmé par la répétition, quand Eli voit Louise et qu’à cinq reprises « Il la regarde encore ». Il nous semble presque entendre les violons ou le tambour alourdir une image déjà explicite.
Alors voilà, Écorces vives produit un effet d’artifice, paradoxalement éloigné du côté sauvage qu’il raconte. Est-ce cela qui nous empêche d’apprécier pleinement ce qui reste indéniablement une forte histoire ? Le roman s’achève sur une métaphore animale. Elle rappelle celle de Stéphane Jolibert avec Dedans ce sont des loups. De quoi nourrir bien d’autres questions.
Caroline de Benedetti
Alexandre Lenot, Écorces vives, Actes Noirs, 2018, 18,50 €, 208 p.
