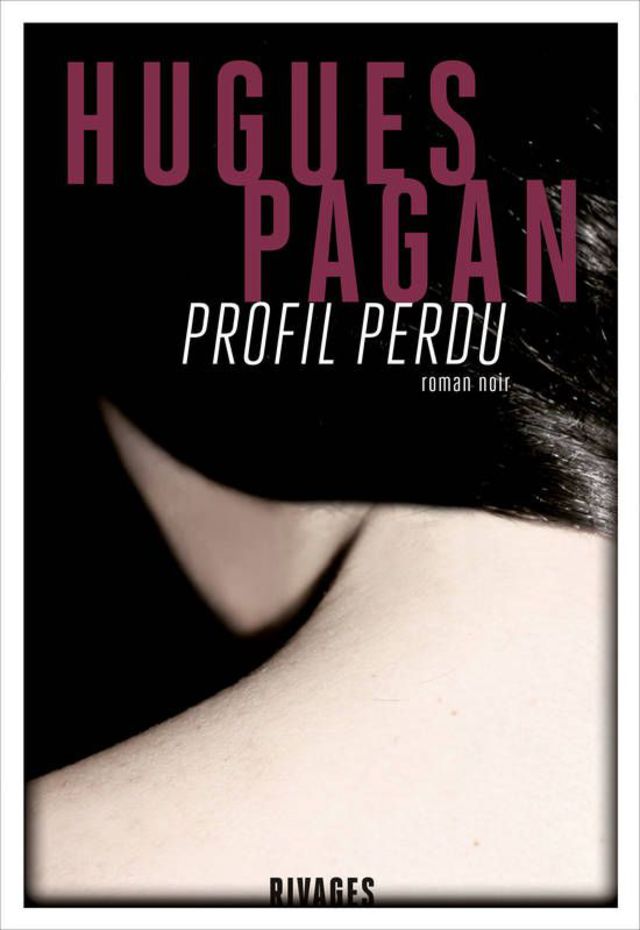 Pagan se range dans le haut du panier du polar français. Ceux pour qui la définition du polar se conçoit avec des policiers dedans sont servis. Pagan, c’est du roman policier. Donc, pas du roman noir, selon la typologie clivante des mêmes. Mais bref… Pagan, c’est un flic qui écrit, un ex-flic. Pris entre l’attraction pour ce métier (celui des « vrais flics » pas comme les planqués de l’IGS, car à choisir « on s’entendaient plus aisément avec les voyous qu’avec les juges »), et le rejet de la hiérarchie et de l’institution qui transpire de ses lignes. Le roman, lui, oscille entre de grands moments portés par le style propre à l’auteur, celui qu’on a tant aimé avec Dernière station avant l’autoroute, et des effets décevants, résumés en une scène. Sur le perron d’un hôtel particulier, Schneider croise Cheroquee : crinière de lionne, grosse poitrine, escarpins et les regards qui font des étincelles pendant que la cigarette ne cesse de brasiller. Lui en trench, elle femme fatale cliché ambulant accoudée au piano à l’écouter jouer sa souffrance. Leur mélodie ne produit rien de surprenant. Ils nous rejouent une scène de cinéma déjà vue. Une scène qui s’inscrit dans le passé du Schneider de Vaines recherches et La mort dans une voiture solitaire.
Pagan se range dans le haut du panier du polar français. Ceux pour qui la définition du polar se conçoit avec des policiers dedans sont servis. Pagan, c’est du roman policier. Donc, pas du roman noir, selon la typologie clivante des mêmes. Mais bref… Pagan, c’est un flic qui écrit, un ex-flic. Pris entre l’attraction pour ce métier (celui des « vrais flics » pas comme les planqués de l’IGS, car à choisir « on s’entendaient plus aisément avec les voyous qu’avec les juges »), et le rejet de la hiérarchie et de l’institution qui transpire de ses lignes. Le roman, lui, oscille entre de grands moments portés par le style propre à l’auteur, celui qu’on a tant aimé avec Dernière station avant l’autoroute, et des effets décevants, résumés en une scène. Sur le perron d’un hôtel particulier, Schneider croise Cheroquee : crinière de lionne, grosse poitrine, escarpins et les regards qui font des étincelles pendant que la cigarette ne cesse de brasiller. Lui en trench, elle femme fatale cliché ambulant accoudée au piano à l’écouter jouer sa souffrance. Leur mélodie ne produit rien de surprenant. Ils nous rejouent une scène de cinéma déjà vue. Une scène qui s’inscrit dans le passé du Schneider de Vaines recherches et La mort dans une voiture solitaire.
Schneider fait partie de la famille des flics cassés. En existe-t-il d’autres dans le polar ? La guerre d’Algérie lui a volé son âme et il pose ses yeux gris (de loup) sur ce qui l’entoure. Son monde est masculin et les femmes existent surtout par rapport aux hommes : s’en passer ou pas, être mère ou pas, pute ou pas…
« Cheroquee sortit de la cabine. Marina en eut le souffle coupé. C’était une autre femme qui venait d’apparaître devant ses yeux. Elle avait la figure chiffonnée et les cheveux en bataille, mais c’était une femme plus lourde et plus pleine, plus remplie de force et d’appétit de vivre. Souriant avec une sorte de gêne, vacillante, trépignant presque sur des talons aiguilles démesurés, Cheroquee donnait seulement l’impression d’avoir plus que jamais une violente envie de pisser. »
Mais de manière incontestable, Pagan a l’art des descriptions évocatrices, de brefs non-dits, de phrases assez puissantes pour que le lecteur entende les mots qui ne sont pas couchés sur le papier. Profil perdu possède la patine du passé, un monde sans téléphone portable, une époque révolue prise entre des illusions perdues et des rêves possibles. L’auteur explique, lors d’une rencontre au festival Toulouse Polars du Sud (autrement nommé TPS), l’importance de « fédérer les gens autour d’une pensée » avec le roman, et avoir voulu évoquer « le colonialisme, le pillage des richesses et l’asservissement des peuples. »
Et puis l’histoire de ce flic abattu par un motard dans une station service, et les ramifications qui se dévoilent lentement, forment une intrigue originale et ample, sans être tape à l’oeil. Pagan c’est un peu comme Olivier Marchal : un filtre très prononcé teinte leurs histoires, il n’est pas question de réalisme, et l’alchimie opère. Les sensations ne vous quittent pas. Car au fond, comme le dit l’auteur à TPS : « Y’a des flics qui écrivent, mais ce ne sont pas des écrivains. N’importe qui peut écrire des histoires de flics, c’est pas compliqué, ça. »
Pour en lire plus sur Hugues Pagan, un regard par ici.
Caroline de Benedetti
Hugues Pagan, Profil perdu, Rivages, 2017, 408 p., 19,90 €

One thought on “Profil perdu de Hugues Pagan”
Comments are closed.