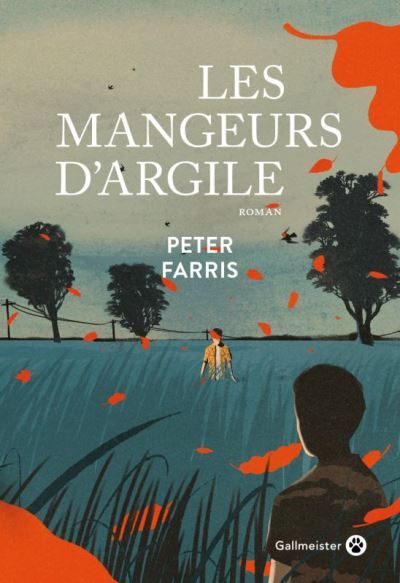Tous les ingrédients d’un « rural noir » sont réunis : un paysage champêtre (forêts et rivières) et les activités – chasse et pêche – qui vont avec. Un monde paisible menacé par les chacals de la finance et de la religion. L’affrontement entre le paisible propriétaire terrien, respectueux de la nature, peu soucieux de s’enrichir en vendant ses terres et « les mangeurs d’argile » prêts à tout pour s’emparer du riche sous sol est le moteur de l’intrigue, somme toute banale. Les personnages habituels du polar rural sont tous présents : du shérif corrompu au spéculateur mafieux en passant par le prédicateur charismatique ; du brave fermier à la pute de haut vol qu’il a épousée, qui le trompe et fait partie du complot pour le tuer.
Nous sommes pourtant face à une œuvre peu banale, par la construction du récit, le mélange de douceur et de brutalité, par les portraits fouillés de personnages hors du commun, comme on en avait côtoyé dans les deux romans précédents de Peter Farris (Dernier appel pour les vivants et Le Diable en personne). Celui-ci est moins violent, mais son intérêt réside, comme les précédents dans la rencontre insolite entre deux personnages que tout oppose (âge, histoire, statut social) mais que réunit une même tristesse, un même sentiment de solitude, littéralement insupportable : Jesse Pelham un adolescent, ravagé par la mort de son père (Richie Pelham, le brave fermier) rencontre dans les bois où il se réfugie pour cacher son chagrin, un « homme filiforme » au comportement étrange (William Pilcher, dit Billy) un vétéran traqué depuis des années par le FBI pour avoir fait sauter « un immeuble avec un fourgon chargé d’explosifs, causant des dizaines de victimes ». Le récit de cette amitié sert de fil conducteur à une intrigue en forme de puzzle composée de nombreux retours en arrière qui permettent la compréhension de l’ensemble structuré comme un moteur à quatre temps : Combustion / Extraction / Propulsion / Accélération (titres des quatre parties du roman).
Peter Farris confirme son talent de conteur dans un style unique mêlant la tendresse à l’humour et remarquablement restitué par la belle traduction d’Anatole Pons : « Il était enhardi par le chagrin, hanté par l’image de son père chutant du mirador, un mirador qui avait été bâti pour lui. Pour un peu il aurait mis un serpent au défi de le mordre. »
Jocelyne Hubert
Peter Farris, Les mangeurs d’argile (The Clay Eaters, 2019), traduction Anatole Pons, Gallmeister, 336 p., 23 euros