 Le titre annonce la couleur : c’est une citation tronquée de l’épitaphe de Marcel Duchamp, reprise intégralement dans l’épigraphe initiale : « D’ailleurs, c’est toujours les autres qui meurent. » Epitaphe de Marcel Duchamp (1887-1968) / sur sa tombe, à Rouen / écrite par lui-même ». La deuxième partie de l’épigraphe cite à nouveau Duchamp, sous sa forme travestie de Rrose Sélavy : « Et Qui libre ». Les amateurs salivent déjà, mais j’en connais à qui ce genre de plaisanteries donne de l’urticaire. Libres à vous d’entrer ou non dans l’univers unique de Jean-François Vilar qui fit en 1982 une entrée fracassante dans la littérature de genre, raflant aussitôt un « grand prix du roman noir » décerné par Télérama .
Le titre annonce la couleur : c’est une citation tronquée de l’épitaphe de Marcel Duchamp, reprise intégralement dans l’épigraphe initiale : « D’ailleurs, c’est toujours les autres qui meurent. » Epitaphe de Marcel Duchamp (1887-1968) / sur sa tombe, à Rouen / écrite par lui-même ». La deuxième partie de l’épigraphe cite à nouveau Duchamp, sous sa forme travestie de Rrose Sélavy : « Et Qui libre ». Les amateurs salivent déjà, mais j’en connais à qui ce genre de plaisanteries donne de l’urticaire. Libres à vous d’entrer ou non dans l’univers unique de Jean-François Vilar qui fit en 1982 une entrée fracassante dans la littérature de genre, raflant aussitôt un « grand prix du roman noir » décerné par Télérama .
Première entrée en scène – littérale et spectaculaire – de Victor Blainville, le narrateur, qui vient de pénétrer dans l’un des passages couverts parisiens, le passage du Caire, le plus ancien. « Je suis entré par la rue Saint-Denis » (première phrase du roman), « Et voici maintenant : ce mannequin, corps féminin, est étendu, allongé, écartelé, sur un lit de brindilles ou peut-être de paille. » Ce corps féminin : poupée ? mannequin ?… ou vrai cadavre ? Pour le savoir, Victor s’approche de la « vitrine encrassée de poussière », gratte la vitre, et cherche le meilleur angle pour photographier la scène. « L’œil s’accoutume. Je vois nettement : des cuisses largement ouvertes révèlent, on ne voit que ça et un rayon de lumière le frappe curieusement, un sexe impubère. » D’autres éléments disparates apparaissent : dans la main gauche de la femme, une lampe. « Une lampe à pétrole. Type lampe pigeon ou bec Auer. » Dans le décor, un cyprès, des nuages et « une imitation de chute d’eau ». Victor finit par se convaincre, d’après la « disposition maniaque » ce corps ne peut pas être « celui d’un mannequin /…/ C’est une femme qui est là, une vraie et qui est morte, évidemment assassinée. » Photographie faite, Victor s’en va « il est 18 heures vendredi 19 juin. » (1981).
Voilà, vous venez d’entrer dans le monde (dés)enchanté de Victor Blainville (tiens donc, comme dans Blainville-Crevon, lieu de naissance de Marcel Duchamp ?). La scène qu’il vient de photographier se situe dans un décor apprécié des surréalistes (Le Paysan de Paris d’Aragon débute Passage de l’Opéra). Ses déambulations dans Paris, « appareil photo à la main » sont de celles que prône André Breton dans Nadja. Bientôt il sera interrogé par un flic nommé Villon (comme le frère de Marcel Duchamp), mais surtout, surtout, il ne tarde pas à faire le lien entre le cadavre dans la vitrine du passage et « ce truc fascinant, Etant donnés, le dernier travail signé Marcel Duchamp. (…) Le titre complet, c’est Etant donnés : 1° La chute d’eau ; 2° le gaz d’éclairage. (…) c’est exposé quelque part aux Etats-Unis, et c’est intransportable. » Raison pour laquelle on ne peut voir cette installation qu’au Philadelphia Museum of Art… selon un dispositif : un trou dans une palissade, qui risque d’échapper au visiteur pressé ! Entreprise « tordue » commente Victor, « plus tordue encore, et ce n’est pas peu dire, que la fameuse Mariée mis à nu, Le Grand verre, etc. » Ajoutons- y Le Nu descendant l’escalier, Apolinère Enameled, La Broyeuse de chocolat… La référence à Duchamp dépasse la simple contextualisation geographico-historique, elle interroge le lecteur sur la notion de représentation : qu’est-ce que la réalité ?
La raison de la présence de Victor Passage du Caire est fort banale : une vieille connaissance (du temps du militantisme actif des années 70) lui a donné rendez-vous là. L’utopie révolutionnaire a vécu. Certains liens tiennent encore – et les vieux dossiers des RG n’ont pas été détruits, prêts à sortir des placards (comme la suite du roman le prouvera !) Parmi ces liens, Marc, rédacteur en chef du journal Le Soir : « Le Grand Soir (mais on dit Le Soir ) est évidemment un journal du matin. Autrefois animé par des bolchos farouches, il a depuis belle lurette, abandonné toutes références à d’éventuels lendemains chantants. Ce qui a permis une sensible augmentation du chiffre des ventes et l’émergence de quelques talents qui s’encroûtaient dans la militance. » Marc est en quelque sorte l’embrayeur narratif des romans de J F. Vilar puisque c’est lui qui commande à Victor les reportages photos prétextes à enquêtes. Un reportage peut en cacher un autre : commandité par Marc pour faire des portraits de manifestants dans le quartier de Beaubourg, Victor, comme par hasard (!) se trouve assister à un extravagant attentat terroriste, conçu comme un happening inspiré d’une œuvre de Duchamp (on ne vous dira pas laquelle, c’est le dernier tiers du roman, et c’est magnifique).
Pas besoin de consultations frénétiques de dictionnaires pour comprendre que Victor Blainville ressemble comme un frère à son créateur qui l’a donc doté du même amour que lui pour pour l’utopie révolutionnaire, pour les villes et pour les chats. Dans C’est toujours les autres qui meurent, le lecteur fait connaissance avec deux chattes, Kamenev et Zinoviev, et un chaton, Radek, qui a bien du mal au début à se faire accepter des deux femelles. Sept ans plus tard, Radek s’ennuie parce que ses copines sont mortes. (Les Exagérés, 1989, voir L’Indic n° 14) alors Victor lui trouve une nouvelle copine, qui porte un nom… évocateur : Bastille !
Pour en savoir plus sur l’oeuvre de Duchamp, évoquée dans le roman voir ce site.
Jocelyne Hubert
Jean-François Vilar, C’est toujours les autres qui meurent, Fayard Noir 1982, réédition Babel 2008, 272 p., 7,70 euros




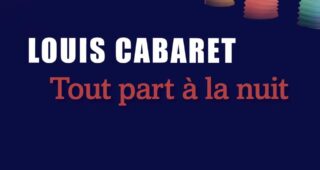
![Ephé[mère] de John N. Turner](https://fonduaunoir.fr/wp-content/uploads/2019/12/3115-Turner-Éphémère-320x170.jpg)